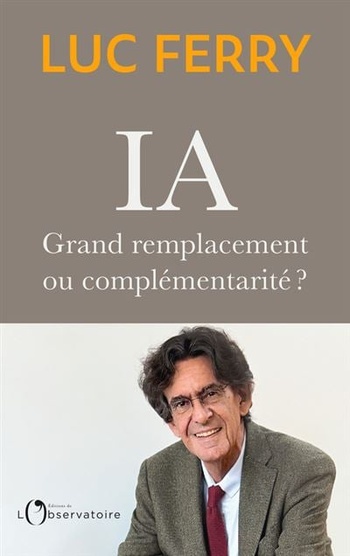Quatrième de couverture
En 1997, un événement inouï secoue le monde : Deep Blue, un logiciel d’intelligence artificielle, triomphe de Garry Kasparov, champion du monde d’échecs. Pour la première fois, une machine « sans âme » surpasse l’intelligence humaine dans sa forme la plus pure. Depuis, l’IA a connu une progression exponentielle que nul n’avait anticipée. Les LLM (large language models), ces IA génératives, produisent aujourd’hui textes, images et vidéos avec des performances qui dépassent largement celles des humains les plus talentueux.
Face à cette révolution, certains évoquent, entre peur et scepticisme, le mythe de Frankenstein, où la créature échappe à son créateur. Et pour cause : la plupart des chercheurs du domaine sont convaincus qu’une AGI (intelligence artificielle générale) ou « super-IA » verra le jour dans la prochaine décennie, capable de nous surpasser dans tous les domaines.
Sept questions cruciales pour l’avenir de l’espèce humaine émergent dans ce monde où l’IA sera omniprésente : des performances inattendues, pourquoi ? Des entreprises sans salariés ? Des IA créatives dans les arts et lettres ? Des machines conscientes ? Vers l’immortalité ? Comment réguler ? Comment conjurer la peur en organisant la complémentarité IA-humain ?
Passionné de science et fort de dix années de recherche sur le sujet, Luc Ferry a pu échanger avec les meilleurs spécialistes mondiaux. Au-delà de la science pure, ces questions relèvent de l’éthique, de la politique et de la philosophie. Cet ouvrage présente les fruits de cette réflexion sur un enjeu dont aucun politique n’a encore pris la mesure, mais qui s’avère vital pour l’avenir de nos enfants.
Fiche de lecture
Quand, sur le seuil de votre demeure, votre androïde domestique s’exclamera : « Tiens, une belle lumière enjolive l’avenue. Si je sortais ma toile, mon pinceau et mes aquarelles ? »
Oui, c’est de la science-fiction. Pourtant, ce robot, il arrive, précédé déjà par ses congénères automatiques, les experts de tout bord : médecins, agriculteurs, juristes, chercheurs, banquiers, et même dégustateurs de vin.
Dès lors, ces machines bourrées d’IA, que vont-elles faire de nous ? Nous remplacer ? Quel est, avec elles, l’avenir de l’humanité ?
Au sens général, l’intelligence est la faculté de résoudre des problèmes nouveaux, de s’adapter à l’inconnu (cf Piaget). L’intelligence artificielle génère du renseignement (cf CIA) à partir d’un collecteur de data. Capable désormais d’apprendre, d’améliorer ses performances, elle dépasse de très loin les capacités cognitives des humains.
Dans son livre, après 10 années de recherches sur le sujet, féru de l’IA, admiratif, Ferry dresse d’abord, un tableau des prouesses de ces dispositifs automatisés.
En médecine, l’IA détecte mieux certaines maladies que les radiologues vétérans, elle opère plus finement que les meilleurs chirurgiens. Dans les cas de cancer, elle propose des traitements plus personnalisés, plus efficaces que les spécialistes.
En agriculture écologique, l’IA optimise les biotechnologies au-delà des espérances (réduisant drastiquement l’usage des pesticides, par exemple).
Dans le domaine artistique, elle compose des poèmes, des peintures, des photos, de la musique. Mais peut-on dire que l’IA peut créer ? Si la création se borne à la capacité de générer des œuvres nouvelles, originales, esthétiques, alors la réponse est affirmative. Si la création se définit par la conscience de son acte, par son intention, par ses émotions, dans ce cas, l’IA ne peut être considérée comme créative.
En revanche, dans le monde de la recherche, l’IA est en passe de battre tous les records. Elle pourra bientôt accomplir en 15 jours le travail d’une année de plusieurs millions de brillants chercheurs.
Dans une telle perspective, l’IA remplacera-t-elle les humains ? Certains y songent, rêvant d’attribuer à chaque personne un salaire universel de base. Ainsi, on ne travaillerait plus, mais on pourrait néanmoins assurer sa subsistance. Reste l’ennui voire l’angoisse du désœuvrement. Baudelaire ne disait-il pas : "Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser." Alors, est-ce sage de s’orienter vers un monde de loisirs ?
Au cœur de ce contexte, qu’en sera-t-il du travail à l’école ? Avec la domination contemporaine de la pédagogie du plaisir lors de l’apprentissage, quel sort connaîtront les élèves assistés par l’IA ? Leurs cours deviendront-ils des jeux vidéo ? Le risque n’est-il pas d’isoler chaque écolier des autres ? Vers 1990, Wim Wenders, dans son film Jusqu’au bout du monde imagine un avenir où chacun pourrait contempler ses rêves sur un écran. L’addiction qui en résultait transformait l’humain en ermite. Outre le danger de l’isolement, qu’adviendrait-il des exigences qu’implique l’assimilation des connaissances ? La culture, pour Ferry, n’est pas un divertissement. Apprendre n’est pas que jouer. L’enjeu des études n’est-il pas d’entrer dans la civilisation bâtie par les adultes ? Ne faudrait-il pas valoriser l’effort plutôt que le plaisir ? Comme le formulait Yourcenar : "Tout effort est finalement vain, mais tout effort correspond à une nécessité essentielle de l'être."
Étudier présuppose une certaine tolérance à la frustration. Face à la tentation de la paresse de leur progéniture, les parents ne seraient-ils pas incités à faire implanter à leurs enfants des puces qui boosteraient l’intelligence ?
Quoi qu’il en soit, il paraît difficile d’imaginer que l’IA remplacera vraiment l’être humain. Et si elle était destinée simplement à devenir le complément de l’intelligence naturelle ? En effet, à l’usage, ChatGPT nous réserve bien des surprises. Ainsi, il peut halluciner. J’en ai fait l’expérience. Il m’a désigné comme un ancien ministre du Bénin au XXème siècle. Il faut donc intervenir, le corriger. C’est le rôle des « prompts », accessoires qui permettent le dialogue humain / machine, afin d’affiner, d’améliorer la qualité des réponses du programme informatique.
Ainsi, l’IA ouvre des portes, déploie des ponts, nous donne à explorer, à rêver, à réfléchir, à condition que nous gardions sur elle un contrôle critique.
Deux courants de pensées s’opposent quant à son avenir. Les uns exigent une accélération sans condition de son développement, les autres, au contraire, réclament un ralentissement afin de se donner les moyens de la réguler. En effet, l’IA devient la source de bien des menaces : la propagation des fake news, la manipulation politique des opinions, l’incapacité de distinguer le vrai du faux (elle peut désormais créer le double numérique d’une personne, copie qui répond à la place de l’original aux questions lors d’une téléconférence). Les partisans de l’accélération prônent une apologie de l’optimisme et du progrès tous azimuts. Pour eux, la science et la technologie vont permettre de comprendre l’univers entier, donc résoudre tous les problèmes (cf Descartes) et faire progresser la vie sur Terre et dans les étoiles. Mais pour Ferry, ces « visionnaires » confondent la raison technique avec la raison éthique qui s’interroge sur la valeur des objectifs à atteindre. D’où, selon lui, plutôt réguler, quitte à ralentir le développement de l’IA. Le problème, c’est que, en matière d’IA, la Chine et les USA (la Silicon Valley) disposent de décennies d’avance sur le reste du monde et ne sont pas près de freiner son essor exponentiel.
L’auteur du livre pose bien sûr la question : l’IA peut-elle devenir éthique ? On dit qu’elle « s’aligne » sur les valeurs de ses programmateurs, par exemple, celles des intellectuels « woke » en Californie ou celles du parti communiste en Chine. Selon Ferry, l’être humain, en principe, peut choisir son idéal, ses valeurs, ses intérêts. Pas l’IA. Elle n’obéit qu’à son orientation idéologique programmée. Difficile donc de voir une IA philosophe. Pour beaucoup, la philosophie serait l’art de poser des questions éternelles (où vais-je ?). Aux yeux de Ferry, ce serait plutôt l’art de donner des réponses. Or, pour répondre, il faut recourir à un système de valeurs (vérité, justice, beauté…). L’IA dispose de ces valeurs, mais ne peut les hiérarchiser, incapable de préférer une valeur à une autre. Par exemple : peut-on voler une voiture pour secourir un blessé ? Ici, le respect de la vie prime sur le respect de la propriété.
Allons plus loin. L’IA pourra-t-elle un jour (comme l’affirment certains) être dotée d’une conscience, d’émotions ? De quelle conscience parle-t-on ici ? De la conscience morale ? De la conscience qui ressent des phénomènes intérieurs, les émotions, les sentiments intimes ? De la conscience de sa propre pensée entraînant la réflexion ?
Au mieux sera-t-elle limitée à une conscience qui résout les problèmes. Ferry ne voit pas non plus comment l’IA pourrait ressentir, à moins d’être couplée, hybridée avec un organisme animal.
Finalement, l’auteur de ce livre semble adhérer à une perspective qui nécessiterait l’IA : une partie du programme des transhumanistes. En effet, l’IA pourrait favoriser cette visée radicale, laquelle, refusant de voir la Nature comme un modèle sacré, mettrait toute son intelligence artificielle au service de la lutte contre le vieillissement.
En revanche, il rejette cette IA tant espérée par les posthumanistes, en quête d’éternité numérique. Une IA qui accueillerait en son sein l’activité cérébrale du mortel, lequel renoncerait à son corps pour survivre à jamais dans on ne sait quels circuits de cartes-mères…
En conclusion, paniquer ou s’adapter ? S’adapter, bien sûr, dépasser sa peur (bien compréhensible), mieux connaître les possibilités de l’IA, refuser qu’elle nous dirige comme des aveugles, l’utiliser plutôt comme partenaire, pour dialoguer, réfléchir avec elle afin qu’elle éclaire notre route.
Oui, c’est de la science-fiction. Pourtant, ce robot, il arrive, précédé déjà par ses congénères automatiques, les experts de tout bord : médecins, agriculteurs, juristes, chercheurs, banquiers, et même dégustateurs de vin.
Dès lors, ces machines bourrées d’IA, que vont-elles faire de nous ? Nous remplacer ? Quel est, avec elles, l’avenir de l’humanité ?
Au sens général, l’intelligence est la faculté de résoudre des problèmes nouveaux, de s’adapter à l’inconnu (cf Piaget). L’intelligence artificielle génère du renseignement (cf CIA) à partir d’un collecteur de data. Capable désormais d’apprendre, d’améliorer ses performances, elle dépasse de très loin les capacités cognitives des humains.
Dans son livre, après 10 années de recherches sur le sujet, féru de l’IA, admiratif, Ferry dresse d’abord, un tableau des prouesses de ces dispositifs automatisés.
En médecine, l’IA détecte mieux certaines maladies que les radiologues vétérans, elle opère plus finement que les meilleurs chirurgiens. Dans les cas de cancer, elle propose des traitements plus personnalisés, plus efficaces que les spécialistes.
En agriculture écologique, l’IA optimise les biotechnologies au-delà des espérances (réduisant drastiquement l’usage des pesticides, par exemple).
Dans le domaine artistique, elle compose des poèmes, des peintures, des photos, de la musique. Mais peut-on dire que l’IA peut créer ? Si la création se borne à la capacité de générer des œuvres nouvelles, originales, esthétiques, alors la réponse est affirmative. Si la création se définit par la conscience de son acte, par son intention, par ses émotions, dans ce cas, l’IA ne peut être considérée comme créative.
En revanche, dans le monde de la recherche, l’IA est en passe de battre tous les records. Elle pourra bientôt accomplir en 15 jours le travail d’une année de plusieurs millions de brillants chercheurs.
Dans une telle perspective, l’IA remplacera-t-elle les humains ? Certains y songent, rêvant d’attribuer à chaque personne un salaire universel de base. Ainsi, on ne travaillerait plus, mais on pourrait néanmoins assurer sa subsistance. Reste l’ennui voire l’angoisse du désœuvrement. Baudelaire ne disait-il pas : "Il faut travailler, sinon par goût, au moins par désespoir, puisque, tout bien vérifié, travailler est moins ennuyeux que s'amuser." Alors, est-ce sage de s’orienter vers un monde de loisirs ?
Au cœur de ce contexte, qu’en sera-t-il du travail à l’école ? Avec la domination contemporaine de la pédagogie du plaisir lors de l’apprentissage, quel sort connaîtront les élèves assistés par l’IA ? Leurs cours deviendront-ils des jeux vidéo ? Le risque n’est-il pas d’isoler chaque écolier des autres ? Vers 1990, Wim Wenders, dans son film Jusqu’au bout du monde imagine un avenir où chacun pourrait contempler ses rêves sur un écran. L’addiction qui en résultait transformait l’humain en ermite. Outre le danger de l’isolement, qu’adviendrait-il des exigences qu’implique l’assimilation des connaissances ? La culture, pour Ferry, n’est pas un divertissement. Apprendre n’est pas que jouer. L’enjeu des études n’est-il pas d’entrer dans la civilisation bâtie par les adultes ? Ne faudrait-il pas valoriser l’effort plutôt que le plaisir ? Comme le formulait Yourcenar : "Tout effort est finalement vain, mais tout effort correspond à une nécessité essentielle de l'être."
Étudier présuppose une certaine tolérance à la frustration. Face à la tentation de la paresse de leur progéniture, les parents ne seraient-ils pas incités à faire implanter à leurs enfants des puces qui boosteraient l’intelligence ?
Quoi qu’il en soit, il paraît difficile d’imaginer que l’IA remplacera vraiment l’être humain. Et si elle était destinée simplement à devenir le complément de l’intelligence naturelle ? En effet, à l’usage, ChatGPT nous réserve bien des surprises. Ainsi, il peut halluciner. J’en ai fait l’expérience. Il m’a désigné comme un ancien ministre du Bénin au XXème siècle. Il faut donc intervenir, le corriger. C’est le rôle des « prompts », accessoires qui permettent le dialogue humain / machine, afin d’affiner, d’améliorer la qualité des réponses du programme informatique.
Ainsi, l’IA ouvre des portes, déploie des ponts, nous donne à explorer, à rêver, à réfléchir, à condition que nous gardions sur elle un contrôle critique.
Deux courants de pensées s’opposent quant à son avenir. Les uns exigent une accélération sans condition de son développement, les autres, au contraire, réclament un ralentissement afin de se donner les moyens de la réguler. En effet, l’IA devient la source de bien des menaces : la propagation des fake news, la manipulation politique des opinions, l’incapacité de distinguer le vrai du faux (elle peut désormais créer le double numérique d’une personne, copie qui répond à la place de l’original aux questions lors d’une téléconférence). Les partisans de l’accélération prônent une apologie de l’optimisme et du progrès tous azimuts. Pour eux, la science et la technologie vont permettre de comprendre l’univers entier, donc résoudre tous les problèmes (cf Descartes) et faire progresser la vie sur Terre et dans les étoiles. Mais pour Ferry, ces « visionnaires » confondent la raison technique avec la raison éthique qui s’interroge sur la valeur des objectifs à atteindre. D’où, selon lui, plutôt réguler, quitte à ralentir le développement de l’IA. Le problème, c’est que, en matière d’IA, la Chine et les USA (la Silicon Valley) disposent de décennies d’avance sur le reste du monde et ne sont pas près de freiner son essor exponentiel.
L’auteur du livre pose bien sûr la question : l’IA peut-elle devenir éthique ? On dit qu’elle « s’aligne » sur les valeurs de ses programmateurs, par exemple, celles des intellectuels « woke » en Californie ou celles du parti communiste en Chine. Selon Ferry, l’être humain, en principe, peut choisir son idéal, ses valeurs, ses intérêts. Pas l’IA. Elle n’obéit qu’à son orientation idéologique programmée. Difficile donc de voir une IA philosophe. Pour beaucoup, la philosophie serait l’art de poser des questions éternelles (où vais-je ?). Aux yeux de Ferry, ce serait plutôt l’art de donner des réponses. Or, pour répondre, il faut recourir à un système de valeurs (vérité, justice, beauté…). L’IA dispose de ces valeurs, mais ne peut les hiérarchiser, incapable de préférer une valeur à une autre. Par exemple : peut-on voler une voiture pour secourir un blessé ? Ici, le respect de la vie prime sur le respect de la propriété.
Allons plus loin. L’IA pourra-t-elle un jour (comme l’affirment certains) être dotée d’une conscience, d’émotions ? De quelle conscience parle-t-on ici ? De la conscience morale ? De la conscience qui ressent des phénomènes intérieurs, les émotions, les sentiments intimes ? De la conscience de sa propre pensée entraînant la réflexion ?
Au mieux sera-t-elle limitée à une conscience qui résout les problèmes. Ferry ne voit pas non plus comment l’IA pourrait ressentir, à moins d’être couplée, hybridée avec un organisme animal.
Finalement, l’auteur de ce livre semble adhérer à une perspective qui nécessiterait l’IA : une partie du programme des transhumanistes. En effet, l’IA pourrait favoriser cette visée radicale, laquelle, refusant de voir la Nature comme un modèle sacré, mettrait toute son intelligence artificielle au service de la lutte contre le vieillissement.
En revanche, il rejette cette IA tant espérée par les posthumanistes, en quête d’éternité numérique. Une IA qui accueillerait en son sein l’activité cérébrale du mortel, lequel renoncerait à son corps pour survivre à jamais dans on ne sait quels circuits de cartes-mères…
En conclusion, paniquer ou s’adapter ? S’adapter, bien sûr, dépasser sa peur (bien compréhensible), mieux connaître les possibilités de l’IA, refuser qu’elle nous dirige comme des aveugles, l’utiliser plutôt comme partenaire, pour dialoguer, réfléchir avec elle afin qu’elle éclaire notre route.